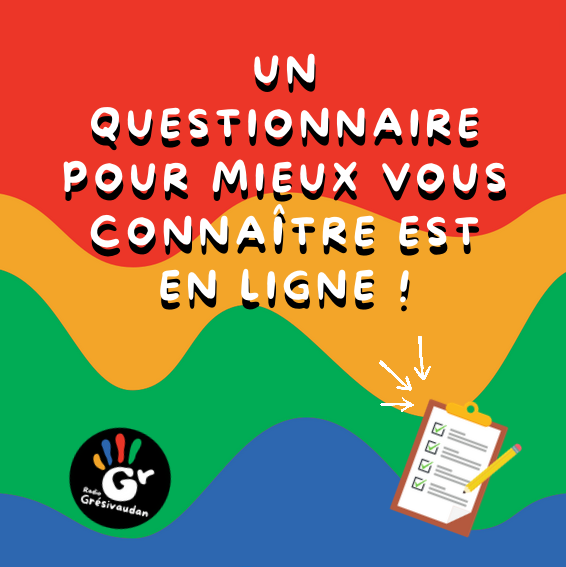Radio Grésivaudan cherche à connaître ses auditeurs et auditrices plus en détail, qu’ils soient réguliers ou pas ! Répondre au…
Les éditoriaux
EVENEMENT – Scène Ouverte – le samedi 18 novembre 2023 à partir de 19h00
Ami.e Méloman BONJOUR ! Radio Grésivaudan est fière de te convier à sa Scène Ouverte, organisée avec la Douc’Heure de…
Chronique du 21 septembre 2023
You were my september song Time moves so slowly,when you’re only fifteen Do you remember me, we were only fifteen…
Chronique du 30 aout 2023
Chroniqque ? Voire. Faudrait-il que je ressassasse chaque mois les mêmes sujets, que je m’indignasse des mêmes horreurs, des mêmes trumperies…
Chronique du 31 juillet 2023
Juillet, c’est fini. Il était temps. Le mois se meurt dans une sorte de laisser-aller oùtout prend la même importance….
The « twelve » is out and the whole pepole is crying a lot
The « twelve » is out and the whole people is crying a lot. Est-ce manquer de respect que de tenter d’apporter…
Service Civique
Tu as envi de découvrir le fonctionnement d’une radio associative ? Tu as entre 18 et 25 ans ? Radio…
De toute façon en août il ne se passe jamais rien
Chroniquer c’est relater dans l’ordre les événements qui construiront l’histoire, la petite ou la grande, le chroniqueur n’étant qu’un rapporteur…
Suis-je devenu réac ?
Depuis plusieurs semaines une question me tarabuste. A tel point que parfois même j’en perds le bon sens et que…
Que dire ? Faut-il dire même ?
Je sais bien que le travail, le devoir même, d’un chroniqueur, c’est de raconter, dans l’ordre chronologique, les événements de…